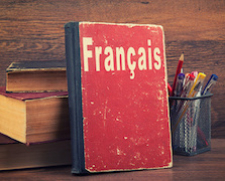
9 | 7600 Consultations
La langue française est si riche que nous avons décidé de l’honorer en publiant de temps à autre un article axé sur quelques-unes de ses particularités. Nous avons choisi de nous pencher cette semaine sur certaines expressions, parfois singulières et drôles, tournant autour du thème du souci, de l’inquiétude, de la préoccupation, et d’en découvrir l’origine. Décortiquons un peu ces formules.
Se faire de la bile /du mouron
La « théorie humorale » a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la médecine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Cette théorie considérait que la santé de l'âme, comme celle du corps, résidait dans l'équilibre des humeurs (sang, bile jaune, bile noire) et des qualités physiques (chaud, froid, sec, humide) qui les accompagnaient. Ainsi, l’on considérait que la bile jaune ou bile ordinaire, sécrétée par le foie et qui s’écoule dans l’intestin au moment de la digestion, avait une influence déterminante sur le tempérament selon sa composition et sa proportion. La bile était également associée aux diverses formes ou manifestations de la colère (irritabilité, agressivité, aigreur, amertume, etc.). D’ailleurs, pour émouvoir, exciter ou irriter, on dit alors « remuer la bile » (de quelqu'un). Pour déverser, décharger, exhaler, on disait « vomir sa bile (sur quelqu'un) ». Avoir la bile enflammée signifiait être dans une grande colère. Molière y fit allusion dans Le Misanthrope, avec notamment cette réplique d’Alceste : « Ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile ». Quant au « mouron », il vient d'un terme d'ancien français signifiant la chevelure et peut s'apparenter à l'expression « se faire des cheveux blancs. » Il s'agirait donc de s'inquiéter de telle sorte qu'on en est involontairement réduit à se faire des cheveux blancs.
Se faire du mauvais sang, un sang d’encre ou se ronger les sangs
« Se faire du mauvais sang » est une expression médiévale remplie de bon sens puisqu’elle signifie fabriquer du sang de mauvaise qualité à cause des soucis qui perturbent. Sans pouvoir dire que le stress influe sur la composition de notre sang, il est néanmoins prouvé qu’il a une influence sur notre santé. L’expression « se ronger les sangs » date du XIXème siècle et est basée sur une métaphore assimilant « les sangs » comme faisant référence au corps humain dans sa totalité. L’origine remonte au moyen-âge, époque pendant laquelle la médecine considérait que l’état général du corps et de l’esprit avait un rapport avec le sang, ce dernier constituant une des humeurs dont l’équilibre assurait la bonne santé. Un déséquilibre sanguin pouvait donc procurer un sentiment d’angoisse et d’inquiétude. On retrouve par exemple cette expression dans L’Assommoir d’Émile Zola : « Gervaise se rongeait les sangs ». Quant à la tournure, « se faire un sang d’encre », elle se réfère à l’équilibre de l’appareil circulatoire, perçu alors comme garant d’une bonne santé ; tout déséquilibre étant source d’indispositions. L’excès de sang favorisait donc un caractère sanguin ou colérique. Ce mauvais sang, noir comme l’encre, qui engendrait soi-disant inquiétude et angoisse ne pouvait alors être assaini que par une bonne saignée !
Se mettre martel en tête
« Se mettre martel en tête » signifie s’inquiéter d’une situation ou au sujet d’une personne. Il ne s’agirait pas d’une référence directe à Charles Martel, mais plutôt à un ancien outil, une sorte de marteau. A l’origine, c’est à dire au 16ème siècle, « avoir martel » signifiait « être perturbé par un sentiment de jalousie ». Mais l’expression prit rapidement le sens de « se faire du souci ». La métaphore compare les tourments, les interrogations répétées et le questionnement ininterrompu à des coups de marteaux dans la tête. Au 18e siècle, le sens de l’expression se figea et désigna l’obsession de préoccupations diverses. Le verbe « marteler » en découle. On peut ainsi lire sous la plume de Voltaire : « Je viens pour soulager le mal qui me martèle. »
Se mettre la rate au court-Bouillon
Hippocrate considérait que cet organe était à l’origine de l’excès de « bile noire », assimilée à la mélancolie ou l’anxiété. Cette expression a fait l’objet, entre autres, d'un titre de San-Antonio, la rate au court-bouillon, en 1965.Cette tournure est à relier aux mauvais traitements qu'on peut infliger à son propre corps lorsqu'on se fait du souci, comme dans les expressions de même sens citées précédemment. On peut alors imaginer une forme d'auto-torture, consistant, parmi de nombreuses autres possibles, à mettre notre pauvre rate à cuire au court-bouillon.
Et vous, connaissez-vous d’autres expressions associées au thème du souci ? Y en a t’il certaines typiques de votre région ? Les utilisez-vous encore aujourd’hui ? Êtes-vous généralement curieux(se) de découvrir l’étymologie de ces formules très imagées ?
Rédaction: Betty_Nelly
Photo © Adobe – Auteur : spaxiax
charlotte4575, 09/10/2020